Edgard VARESE
Créé le jeudi 2 décembre 1954 au Théâtre des Champs-Élysées et retransmis en direct par l’ORTF, Déserts, oeuvre d’un compositeur américain d’origine française et parfaitement inconnu du grand public, Edgard Varèse, figure à juste titre parmi les œuvres musicales – tels le Sacre du printemps de Stravinsky (dans la même salle de concert) ou Pelléas et Mélisande de Debussy – transformées le temps d’une représentation en champs de bataille houleux et chahutés entre « anciens » et « modernes ». Un rapide examen de l’index accompagnant l’édition en CD du concert permet de se rendre compte du formidable tohu-bohu qu’il suscita : (« Premières manifestations du public / le chahut se précise / il s’installe / deuxième salve de manifestations / cris d’oiseaux / chahut / aboiements / chahut jusqu’à la fin / désannonce du concert »). À vrai dire, l’objet sonore du délit, inscrit au cœur d’un programme des plus « classiques » (la soirée débutait avec la Grande Ouverture en si bémol majeur de Mozart pour se clôturer avec la Symphonie pathétique de Tchaïkovski) avait de quoi heurter une audience venue se délecter de pièces de choix du répertoire, des œuvres placées de surcroît sous la houlette du célèbre chef Hermann Scherchen et de l’Orchestre national de France.
Ainsi que le relate un des témoins, « après Mozart, des appariteurs installent des sortes de grands frigidaires blancs… » Ce sont en fait les grands haut-parleurs chargés de diffuser en stéréophonie une série de séquences de sons et de bruits fixés (sirènes de bateaux, rumeurs de la ville, etc.) et montés préalablement dans les studios du Groupe de recherche de musique concrète au sein de la RTF de Pierre Schaeffer, futur gourou de la musique concrète. L’effectif de l’orchestre de Déserts se montre à l’avenant : absence totale de violons (dont Varèse jugeait la sonorité « faible, grêle, pitoyable »), dix-huit instruments à vent (de la flûte au tuba), un piano et quarante-sept instruments percussifs allant du tambour en bois au xylophone. Quant à l’œuvre elle-même, elle repose sur une alternance de séquences entre ces deux ensembles sonores, l’orchestre et l’instrumentum électronique, ce dernier venant s’interpoler entre les passages joués par l’ONF. C’est l’orchestre qui ouvre Déserts : se joue alors devant l’auditeur un stupéfiant spectacle sonore. Après une ouverture solennelle donnée par les cloches tubulaires, des masses sonores soutenues par les vents et découpées par les percussions s’affrontent, s’opposent les unes aux autres et se superposent brutalement.
Pas de contrepoint, d’amorce de mélodie et de ses variations… Rien en somme de familier auquel le mélomane peut se rattacher. Au contraire, c’est presque une terminologie propre à la géologie qui convient pour tenter une description de cette matière musicale portée par l’orchestre : dérives de blocs sonores, collisions, failles ouvertes par de grands intervalles (de septième ou de huitième)... Intervient alors, après un décrescendo de la partie orchestrale, la section préenregistrée diffusée à travers les haut-parleurs (et activée par Pierre Henry) : des sons collectés et agglomérés qui frappent par leur virulence et le caractère abrupt de leurs apparitions. Un monde effervescent et bruyant, tout droit sorti des artères de la ville et des machines de l’usine, effectue une entrée impromptue dans le temple de la Culture ! Après quelques minutes, retour de l’orchestre dans un nouveau cycle d’alternances qui se répètera encore deux fois pour s’achever après une vingtaine de minutes par les instruments, lors d’un final cherchant sa résolution entre éclat et apaisement.
De façon générale, Déserts abolit la distinction entre son musical et bruit. Si certains compositeurs (George Antheil pour le Ballet mécanique) avaient, par le passé, déjà intégré des bruits dans leur musique, ceux-ci n’agissaient encore que comme simples éléments propres à conférer quelque élément de perturbation, voire de pittoresque, au sein de la palette générale de l’orchestre. En faisant sienne la définition du concept de musique proposée par le philosophe et physicien polonais Josef Hoëné-Wronsky (« la corporification de l’intelligence inscrite dans les sons »), Edgard Varèse préférera dès lors parler de « sons organisés » qui sollicitent pleinement les facultés d’écoute de son audience et dépouillées de tout référent anecdotique. « La musique, après tout, c’est des sons, pas des mots… Une percussion ne raconte pas d’histoire. » Mais, si la musique se voit dès lors privée de texte apparent, elle n’exclut pas pour autant l’invocation d’images. Toutefois, celles-ci, dans l’hypothèse d’un film qui accompagnerait la musique, « ne seront jamais descriptives, et l’image visuelle et le son organisé ne se doubleront pas l’un l’autre… Ces images devraient évoquer l’idée de désert, évoquer plusieurs aspects du désert : les déserts de la terre ; en sable, en neige ; les déserts de la mer; les déserts du ciel, les galaxies, les nébuleuses, etc., mais particulièrement les déserts dans l’esprit de l’homme. » En 1994, vingt-neuf ans après la mort du compositeur, le vidéaste Bill Viola en composera une partition visuelle.
Bouleversant les hiérarchies musicales et libérant les sons et les timbres du carcan de l’écriture, Déserts – à l’instar d’autres jalons de l’avant-garde de l’après-guerre (les compositeurs du Domaine musical, Stockhausen, Schaeffer) – aura fait figure d'œuvre pionnière et annoncé avec fracas les nouvelles aventures musicales des décennies suivantes, mais est également devenue le témoin infortuné de l’incompréhension grandissante – et prenant avec le poids des ans la forme d’une indifférence mutuelle – entre le grand public, les mélomanes et la création musicale contemporaine dite « savante ».
(Jacques de Neuville)
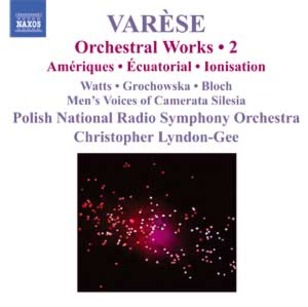
 écouter
écouter